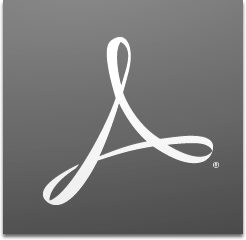L’adoption de la loi Duplomb suscite de vifs débats. Si la mobilisation citoyenne et les interrogations sont légitimes, la vérité des faits doit être rappelée, car l’agriculture mérite mieux que les caricatures.
Nos agriculteurs : les premiers écologistes de France
Oui, les agriculteurs utilisent des produits phytopharmaceutiques. Mais ils le font avec responsabilité. Et surtout, ils sont les premiers à vouloir protéger l’environnement, car la terre, l’eau et la biodiversité sont leur outil de travail. Ce sont eux qui vivent chaque jour les effets du dérèglement climatique et qui cherchent des solutions concrètes.
Ils innovent, réduisent leurs apports, mettent en place des pratiques agroécologiques et sont engagés dans une transition constante.
Une agriculture française à la fois vertueuse et en danger
L’agriculture française est la plus encadrée d’Europe en matière de produits phytopharmaceutiques. Elle respecte les normes sanitaires les plus strictes. Pourtant, elle est aujourd’hui confrontée à un double défi : répondre à une exigence environnementale croissante, tout en restant compétitive face aux produits importés qui n’ont pas les mêmes contraintes.
La loi Duplomb vise aussi à rétablir une forme d’équité entre les agriculteurs français et leurs voisins européens, afin de préserver notre souveraineté alimentaire dans un contexte de concurrence mondialisée.
Nous partageons tous l’ambition d’une alimentation plus durable.
Mais affaiblir notre modèle agricole, c’est ouvrir la porte aux importations de produits venus de pays où les règles sont bien moins exigeantes — sur l’environnement, la santé, ou le droit du travail – alors qu’ils sont consommés par les citoyens qui, dans le même temps, demandent une agriculture 100 % bio en France.
C’est un non-sens écologique et économique.
Cette loi n’est pas un retour en arrière : elle vise sauver une filière essentielle.
La filière sucrière est particulièrement fragilisée. La France a déjà perdu 4 sucreries en quelques années, dont 2 dans les Hauts-de-France, mettant en péril toute une chaine de valeur locale et nationale.
Comprendre l’usage réel de l’acétamipride
Comme pour un médicament, c’est la dose et l’usage qui font la différence. Le paracétamol soigne la fièvre à faible dose, mais devient toxique s’il est mal utilisé. Il en va de même pour les produits phytopharmaceutiques.
Dans le cas de l’acétamipride, autorisé par la loi Duplomb, il ne s’agit ni de pulvérisation, ni de traitement généralisé. Le produit est appliqué en microdoses, par enrobage sur les graines. Il agit ainsi de manière ciblée, sans se diffuser dans l’environnement.
Cette autorisation concerne uniquement des cultures non florifères, comme la betterave sucrière, qui n’attirent pas les pollinisateurs, ce qui élimine tout risque pour les abeilles.
Enfin, les analyses montrent qu’aucun résidu d’acétamipride n’est détecté dans les récoltes. L’évaluation scientifique menée par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) conclut que, dans les conditions d’utilisation strictement encadrées, ce produit ne présente pas de risque pour la santé humaine ni pour l’environnement.
Certains chercheurs indépendants alertent sur des effets possibles en cas de mauvaise utilisation ou de forte exposition. Mais ces scénarios ne correspondent ni aux pratiques actuelles, ni au cadre réglementé français, validé par l’ANSES.
Une mesure dérogatoire, encadrée et transitoire
La loi Duplomb autorise de manière dérogatoire, pour une durée de 3 ans maximum, l’usage de l’acétamipride sur certaines cultures spécifiques - principalement la betterave sucrière – cela concerne qu’1,7 % des surfaces agricoles françaises.
Ce produit, autorisé dans la majorité des pays européens, était jusqu’ici interdit en France. Cette interdiction créait une distorsion de concurrence, pénalisant nos producteurs.
Ce retour temporaire est directement lié à la recrudescence d’un virus redoutable : la jaunisse virale, transmise par les pucerons. Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes, certains agriculteurs ont connu jusqu’à 60 % de pertes de récolte, cela fragilise les exploitations et accentue notre dépendance aux importations.
Sans alternative immédiate, les agriculteurs sont contraints de recourir à d’autres produits, souvent plus nombreux et moins ciblés.
Cette dérogation permet donc de sortir d’une impasse agronomique, éviter des pertes économiques majeures, préserver une filière stratégique et gagner du temps jusqu’à l’arrivée de nouvelles variétés, attendues à partir de 2027.
Il ne faut pas oublier que cette loi est le fruit de plus d’un an de mobilisation professionnelle. Les agriculteurs se sont battus pour obtenir cette mesure transitoire. La voir aujourd’hui aussi malmenée, c’est regrettable.
Il est temps de sortir des caricatures
Nos agriculteurs ne méritent pas d’être pointés du doigt. Ils produisent, innovent, s’adaptent, nourrissent. Ils ont besoin de soutien, de reconnaissance, et de perspectives.
Cessons d’opposer agriculture et écologie. Les deux sont indissociables, et les agriculteurs français le savent mieux que personne.
VOS CONTACTS